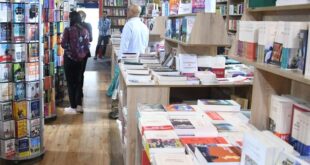Aux confins de l’Espace, une voix marocaine trace son orbite, celle de l’astrophysicienne Maryame El Moutamid, qui a piloté une équipe de recherche et levé le voile sur un nouvel astre autour d’Uranus. Une découverte rendue possible grâce au télescope spatial James Webb. Dans cet entretien, la scientifique nous plonge au cœur de cette quête céleste.
Quelle a été la genèse de cette recherche ayant abouti à la découverte de cet astre en orbite autour d’Uranus ? Et en quoi a consisté votre contribution à cette découverte ?
Il existe de nombreuses raisons, tant scientifiques que pratiques, de s’intéresser de près aux lunes d’Uranus. Ces satellites naturels jouent un rôle essentiel dans la compréhension globale du système uranien. En les étudiant, on peut mieux appréhender la structure et l’évolution de la planète elle-même, mais aussi celle de ses anneaux, leur origine, les processus qui ont mené à leur formation, ainsi que les mécanismes dynamiques complexes qui permettent leur maintien et assurent leur confinement. Mon implication dans ce domaine s’inscrit dans le cadre du programme d’observation n°6379, dont je suis l’investigatrice principale. À ce titre, j’ai constitué et dirigé une équipe de recherche avec laquelle nous avons élaboré la proposition scientifique (la proposal) du projet et défini la stratégie d’observation, en veillant à aligner nos objectifs sur les capacités instrumentales disponibles et les priorités scientifiques de la mission.
Quelles méthodes scientifiques avez-vous employées pour confirmer son existence ?
Le satellite S/2025 U 1 a été identifié grâce au télescope spatial James Webb (JWST), à l’aide de sa caméra proche infrarouge NIRCam. Les données ont été acquises le 2 février 2025, au cours d’une session d’observation de six heures menée dans le cadre du programme General Observer (ID 6379). Pour permettre la détection de ce satellite extrêmement faible en luminosité, nous avons appliqué une méthode d’empilement d’images à longue pose, chacune d’une durée de 40 minutes, qui ont ainsi été combinées, pour permettre d’amplifier le signal des objets peu brillants. La nouvelle lune se situe à une distance radiale de 56 250 ± 250 km par rapport au centre d’Uranus.
Quelles sont les caractéristiques précises de ce nouvel astre (taille, orbite, composition…) ?
Le satellite S/2025 U 1 possède un diamètre estimé d’environ 10 kilomètres (soit environ 6 miles), ce qui en fait un objet extrêmement petit et difficile à détecter. Sa magnitude apparente élevée, évaluée à environ 25,5 en bande H (proche infrarouge), reflète une luminosité extrêmement faible. Il orbite à une distance d’environ 56 250 km du centre d’Uranus, entre les lunes Ophélia et Bianca, sur une trajectoire quasi circulaire, quasiment coplanaire avec le plan équatorial de la planète. Sa période orbitale est d’environ 0,402 jour, soit près de 9,65 heures. À ce jour, aucune mesure directe de sa composition n’a été réalisée, mais son albédo faible laisse supposer une composition mêlant glace et matériau rocheux sombre, comme cela est souvent observé pour les petits satellites uraniens. La nature régulière et circulaire de son orbite suggère une formation in situ, à proximité de sa position actuelle, plutôt qu’un scénario de capture gravitationnelle.
En quoi cette découverte est-elle importante pour la science, et que peut-elle apporter à la compréhension de notre système solaire, voire à l’humanité, en général ?
Cette découverte revêt une importance majeure, tant sur le plan scientifique que technologique. Elle met en lumière les performances exceptionnelles du télescope spatial James Webb (JWST), capable de détecter un objet d’à peine 10 kilomètres de diamètre situé à près de 3 milliards de kilomètres de la Terre. Une telle prouesse témoigne de la sensibilité remarquable de la caméra proche infrarouge (NIRCam) du JWST.
Sur le plan astronomique, cette lune, provisoirement désignée S/2025 U 1, devient la 29ème connue d’Uranus. Il s’agit de la première découverte de satellite autour de cette planète depuis plusieurs années, et surtout de la toute première lune détectée par le JWST autour d’une planète du Système solaire. S/2025 U 1 évolue dans une région particulièrement dynamique, entre les lunes Ophélia et Bianca, au sein d’une zone où les interactions gravitationnelles entre les lunes et les anneaux sont intenses. Ce contexte complexe pourrait expliquer pourquoi cet objet était resté invisible jusqu’à présent.
Sa détection ouvre ainsi de nouvelles perspectives sur la structure interne du système uranien, la présence d’un corps si petit suggère qu’il pourrait exister d’autres lunes encore non détectées. Étudier cette lune pourrait aussi révéler si elle partage une origine commune avec les anneaux d’Uranus, contribuant ainsi à mieux comprendre les relations complexes entre planètes, lunes et systèmes d’anneaux.
Existe-t-il des difficultés particulières à l’étude du système uranien, en comparaison avec d’autres planètes ?
Le système uranien est difficile à étudier pour plusieurs raisons principales. Tout d’abord, Uranus se trouve à environ 2,9 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui complique les observations directes et nécessite des instruments très puissants. Ensuite, ses lunes sont souvent petites et peu lumineuses, tandis que ses anneaux, sombres et fins, restent difficiles à détecter même avec de grands télescopes. Enfin, l’axe d’inclinaison d’Uranus est presque horizontal, avec une inclinaison d’environ 98°, ce qui rend l’étude de ses anneaux et de ses lunes complexe, car leur orientation varie considérablement selon la position de la planète dans son orbite.
En tant qu’astrophysicienne marocaine, que représente cette découverte pour vous personnellement ? Et que peut-elle apporter au Maroc sur le plan scientifique ?
Je suis très heureuse, et profondément touchée par l’intérêt que les médias marocains ont porté à cette découverte. Cela ne m’étonne pas vraiment, les Marocaines et les Marocains sont naturellement curieux et passionnés par les sciences. Une avancée astronomique de cette ampleur suscite, à la fois, enthousiasme et fierté, d’autant plus qu’elle a été réalisée par l’un des nôtres.
Je ressens une immense gratitude et une émotion sincère. Au Maroc, j’ai eu la chance d’être soutenue par des instituteurs et professeurs dévoués, attentifs et exigeants. En France, je reste reconnaissante envers mes professeurs et collègues pour leur engagement. Aux États-Unis, j’ai bénéficié d’opportunités uniques grâce à des collaborations enrichissantes et des infrastructures adaptées. Je remercie ces trois pays pour leur précieuse contribution à mon parcours. Le Maroc connaît un réel progrès scientifique grâce à un engagement fort dans la recherche et l’innovation. Les scientifiques marocains jouent un rôle actif et important sur la scène internationale. Le pays affirme ainsi son rôle dans la science mondiale, où la coopération favorise le progrès pour tous.
Selon vous, comment peut-on améliorer la visibilité des chercheurs marocains sur la scène scientifique internationale ?
Au Maroc, plusieurs moyens sont mobilisés pour encourager la recherche scientifique. Parmi eux, le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) joue un rôle central en finançant et en coordonnant divers projets. De plus, de nombreuses universités et centres de recherche contribuent au développement de la recherche dans différents domaines. Le pays dispose également de programmes de financement, tels que des appels à projets, des bourses et des partenariats avec des organismes internationaux. Par ailleurs, des coopérations internationales sont établies avec plusieurs pays et institutions afin de favoriser les échanges et la formation. Enfin, des initiatives de valorisation, comme les journées scientifiques, les publications et les Salons, sont organisées pour promouvoir la recherche locale.
Quel regard portez-vous sur les moyens déployés pour soutenir la recherche scientifique au Maroc, et quelles pistes d’amélioration préconisez-vous ?
Pour renforcer la recherche scientifique au Maroc, il serait essentiel d’augmenter les budgets dédiés afin de soutenir un plus grand nombre de projets, tout en renforçant les liens entre universités, entreprises et secteurs publics pour stimuler l’innovation appliquée. Il conviendrait également de développer des formations ciblées pour améliorer les compétences en gestion de projets et en communication scientifique, d’encourager la mobilité internationale des chercheurs par le biais d’échanges et de stages, et d’investir dans des infrastructures modernes et facilement accessibles.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui aspirent à réussir dans un domaine aussi exigeant et encore largement masculin que l’astrophysique ?
Pour réussir dans un domaine exigeant comme l’astrophysique, il est essentiel de croire en soi et en ses capacités. Il est, également, important de chercher des modèles et des mentors. La passion, la curiosité et le travail acharné sont des moteurs indispensables, tout comme s’entourer d’un réseau de soutien composé de collègues, amis ou associations. Il faut aussi oser prendre la parole pour défendre ses idées et gagner en visibilité.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel