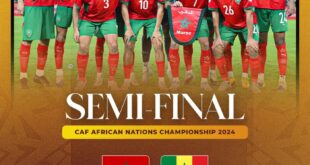Les partis politiques préparent leurs copies en vue d’amender les lois électorales. Des ajustements majeurs refont irruption. Décryptage.
À un an des prochaines élections législatives, le Maroc s’apprête à revoir en profondeur son système électoral. Il va falloir redéfinir les règles en fonction d’un accord partisan qui devrait être corroboré ou tranché au Parlement. Le ministère de l’Intérieur a d’ores et déjà entamé les consultations avec les partis politiques conformément aux orientations Royales du discours du Trône. SM le Roi a appelé à adopter le nouveau Code des élections avant la fin de l’année en cours. Entre-temps, les partis politiques préparent leurs mémorandums. Jusqu’à présent, la discrétion reste de mise. Les formations politiques se gardent de se lancer précocement dans le débat. Au Maroc, les lois électorales changent fréquemment, au gré de la conjoncture politique et des vicissitudes partisanes. La dernière révision du Code électoral est assez récente. Elle date de 2021. Le Maroc vivait encore au rythme de la pandémie du Covid-19. A l’époque, il s’agissait de préparer la première élection à l’ère du Nouveau Modèle de Développement. La réforme, élaborée et votée à la hâte, a été loin de faire l’unanimité au sein de la classe politique. Le système avait subi des changements substantiels. Le quotient électoral a été changé, le seuil supprimé, le calendrier des scrutins (local, régional et législatif) unifié, la liste nationale abrogée au profit des listes régionales favorables à la participation des femmes, le cumul des mandats restreint…Les changements furent tellement profonds qu’ils ont modifié le paysage politique. Toutefois, il n’y a pas eu assez de temps pour mesurer exactement leur impact. D’où le besoin de la révision en cours.
Pour un découpage plus équilibré
Les enjeux sont nombreux. D’abord, le découpage électoral pose problème. Jugée inadaptée aux réalités démographiques et géographiques, la configuration des 92 circonscriptions locales a besoin d’être actualisée en fonction du nouveau recensement général de la population. Une revendication partagée par la majeure partie de la classe politique, selon nos informations. “Il faut impérativement tenir compte des mutations démographiques pour une meilleure équité spatiale dans la représentation nationale, le découpage actuel engendre un déséquilibre dans le poids représentatif des circonscriptions”, explique Abderazak Kabouri, professeur des sciences politiques à l’ENCG-Kénitra, qui met en garde contre les découpages qui produisent souvent des circonscriptions disproportionnées au gré du poids électoral. Selon notre interlocuteur, il est temps de réfléchir à une meilleure intégration des zones rurales qui restent historiquement défavorisées en termes de représentativité par rapport au milieu urbain, ce qui donne un sentiment de marginalisation politique. “Une réforme plus audacieuse pourrait instaurer des correctifs territoriaux temporaires pour garantir une représentation équilibrée”, poursuit-il. En fait, le taux rural de participation demeure élevé, comme cela a été le cas en 2021 où le taux d’inscription avait atteint 94,3%. En parallèle, le doute plane sur la représentativité des jeunes qui a été diluée dans les listes régionales. D’aucuns plaident pour le retour de la liste nationale dédiée à cette catégorie.
Quotient électoral : Repenser la proportionnelle
La carte électorale n’est pas l’unique condition d’une représentativité exemplaire, celle-ci dépend tout aussi du mode du scrutin. Le fameux quotient électoral (nombre de sièges nécessaire pour obtenir un siège) refait surface après avoir suscité de vifs débats en 2021. Alors, il a été modifié en étant calculé sur la base des inscrits au lieu des bulletins valides. Les observateurs et les experts étaient partagés. Il s’agissait d’une aberration pour les uns et d’un gage de pluralité pour les autres. Quoi qu’il en soit, l’indexation sur les inscrits a été pensée de sorte à ouvrir la voie aux petits partis et barrer la route à la domination d’un seul profitant de l’abstention pour rafler les sièges grâce à un électorat mince mais ultra mobilisé. A l’époque, c’était le cas du PJD qui, bien qu’il se soit sentit visé, a paradoxalement bénéficié du nouveau système. D’ailleurs, il doit ses 13 sièges de la Chambre des Représentants au nouveau quotient. Mais, ce système reste décrié puisqu’il ne garantit pas au parti arrivé en tête avec une majorité écrasante de voix d’obtenir plus d’un siège dans certains scénarios, surtout en cas de forte abstention. Cela dit, il arrive qu’un parti majoritaire récolte autant de sièges qu’un parti sans poids électoral. On reproche à ce système de tenir compte de ceux qui n’ont pas voté, de pénaliser le parti en tête, en plus du risque de balkanisation de la scène politique. Pour M. Kabouri, le quotient actuel est un gage de pluralité mais pas de la qualité de la représentation nationale qui dépend plus des élites politiques et de leur proximité avec leurs bases. D’où l’enjeu de la moralisation de la vie politique qui requiert des candidats choisis en fonction de leurs compétences et leur maillage électoral loin de la logique des notables et du «mercato» électoral pour empêcher l’argent d’influencer les urnes. En parlant de qualité, l’intégration des MRE revient en force dans le débat, d’autant que plusieurs partis politiques jugent anormal que la diaspora soit privée de son droit de voter et d’être représentée au Parlement. Saâd Faouzi, membre de la Section MRE au Parti de l’Istiqlal, estime qu’il y a assez d’options dont la mise en place d’un quota au Parlement. Il propose également des incitations financières aux partis présentant des MRE à la tête des listes, que ce soit au niveau local ou régional.
Le spectre de l’abstention
Par ailleurs, la refonte du système électoral intervient dans un contexte de désintérêt des gens pour la chose politique, lequel fait craindre une forte abstention aux élections de 2026, alors que la population en âge de voter augmente en nombre. On est à 25 millions aujourd’hui contre 23 millions en 2016. Les élections précédentes avaient connu un taux de participation élevé (51%) avec 8,78 millions de votants. Un sursaut dû à plusieurs facteurs, dont le vote punitif contre le PJD après dix ans au pouvoir. Cette vague a profité aux partis de centre-droit (RNI, PAM et Istiqlal) qui ont fait un retour triomphal en formant l’une des plus fortes majorités que le Maroc ait connues depuis des années à l’hémicycle. Une conjoncture différente de celle d’aujourd’hui.
Anass MACHLOUKH
Trois questions à Saâd Faouzi : «La représentativité au Parlement n’est pas un luxe, mais une nécessité»
Que pensez-vous de la participation politique des MRE aujourd’hui ?
Avec 5,4 millions de Marocains du Monde, soit 15% de notre population, et 117,7 milliards de dirhams de transferts en 2024, notre diaspora est un pilier stratégique du Maroc. Sa représentativité au Parlement n’est pas un luxe, mais une nécessité pour intégrer ses compétences, défendre ses intérêts. Donner aux MRE une place au Parlement, c’est leur offrir non seulement un siège, mais la capacité d’influencer positivement le présent et l’avenir du Maroc.
Comment doit-on procéder concrètement pour faire entrer les MRE au Parlement ?
Les MRE ne doivent pas être mis à l’écart dans des “circonscriptions dédiées” qui les isoleraient de la dynamique politique nationale. Au contraire, ils doivent être intégrés pleinement dans nos institutions. Concrètement, je propose le quota d’un tiers des représentants MRE dans les deux Chambres du Parlement, pour garantir une masse critique et une influence réelle sur les décisions nationales. Il faut également une participation institutionnelle dans les Conseils régionaux afin de renforcer le lien entre la diaspora et les territoires d’origine. Pensons aussi à des incitations financières pour les partis politiques qui présentent au moins 20% de candidats MRE en tête de liste locale et régionale, afin de transformer l’intention en engagement concret.
Quel est le rôle que doivent jouer les partis dans ce sens ?
Nous devons moderniser nos partis politiques pour les rendre attractifs aux talents de la diaspora : nos experts, chercheurs, entrepreneurs et leaders du monde entrepreneurial et technologique doivent sentir que leur voix compte, que leur vision du monde et leur expérience internationale enrichissent le débat national et que leur engagement a un impact concret sur l’avenir du Maroc. L’intégration des MRE dans nos instances n’est pas un choix optionnel, c’est une condition pour mobiliser pleinement ce capital humain exceptionnel au service de notre développement et de notre rayonnement.
Recueillis par A. M.
Trois questions à Abderazak Kabouri : «Le nouveau découpage électoral doit tenir compte des mutations démographiques»
Est-ce qu’il y a besoin de redéfinir le découpage actuel des circonscriptions ?
Le nouveau découpage électoral doit impérativement tenir compte des mutations démographiques telles que dévoilées par le recensement de 2024. Certains centres urbains et ruraux connaissent une croissance démographique notable tandis que d’autres reculent. Maintenir le découpage actuel crée un déséquilibre dans le poids représentatif des circonscriptions. La réforme doit reposer sur des critères transparents et objectifs dont la population, l’homogénéité démographique, la représentation équilibrée des femmes, des jeunes et des MRE. Malgré la prise en compte de facteurs géographiques et sociaux, l’évolution inégale de l’urbanisation et de la croissance démographique impose une révision périodique qui garantit la justice spatiale dans la représentation. Le plafond constitutionnel du nombre de sièges à la Chambre des Représentants limite toutefois toute refonte structurelle majeure, mais il n’empêche pas des ajustements territoriaux ciblés.
On parle aujourd’hui de l’abstention qui risque de peser lourd sur les prochaines élections. Partagez-vous cette vision ?
Si l’État porte la responsabilité de garantir des élections libres et équitables, l’encadrement politique incombe principalement aux partis politiques. La légitimité des institutions dépend de la participation populaire. Un faible taux de participation ouvre la voie à des discours radicaux visant à délégitimer les institutions, réduisant ainsi l’adhésion citoyenne. L’abstention est observable de façon structurelle depuis 2007 et varie selon les circonscriptions, mais reste en gros importante. La conjoncture économique et sociale pourrait accentuer ce désengagement lors des prochaines élections. Un tel scénario favoriserait mécaniquement le parti obtenant la majorité relative et perpétuerait une configuration électorale insatisfaisante pour la majorité silencieuse des non votants.
Quel serait l’impact de l’intégration des MRE ?
La Constitution reconnaît pleinement aux MRE le droit de participation politique, que ce soit par vote direct ou par procuration. Cela maintient un lien politique fort avec la diaspora. Pour garantir leur représentation directe au Parlement, il faut des ajustements ainsi qu’un engagement accru des partis pour intégrer les compétences issues de la diaspora. Intégrer pleinement les MRE dans le système représentatif permettrait aussi de renforcer la diplomatie parallèle du Royaume.
Recueillis par A. M.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel