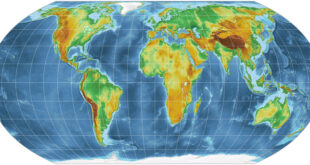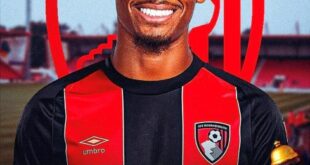La vague de chaleur se prolonge sur l’ensemble du Royaume, tandis que le Nord du pays, déjà frappé par plusieurs incendies de forêts cette dernière semaine, reste en alerte. Le Maroc parvient-il à maîtriser la situation, alors que l’ensemble du bassin méditerranéen fait face à un risque d’incendie extrême ? Décryptage.
Pivots de la stratégie nationale
Une conscience collective s’est imposée au fil des années, permettant à la stratégie nationale de lutte contre les incendies de porter ses fruits. Le Maroc a multiplié les mesures et renforcé ses moyens d’intervention, notamment grâce à la mise en place d’un système avancé de cartographie et à l’acquisition d’un 7ème Canadair CN-ATS de type CL-415. La flotte aérienne est désormais déployée de manière stratégique dans les zones les plus exposées, garantissant des interventions plus rapides et plus efficaces. L’arrivée du CL-415, bombardier d’eau amphibie spécialement conçu pour la lutte contre les feux de forêts, constitue un atout majeur. Plus performant que son prédécesseur, le CL-215, il peut emporter jusqu’à 6137 litres d’eau et se ravitaille directement dans les lacs. Polyvalent, l’appareil peut également être mobilisé pour des missions de recherche, de sauvetage ou de transport de personnes et de matériel. «Ces avions ont été mobilisés dans sept incendies majeurs, réalisant environ 250 largages et protégeant ainsi 19.000 hectares de forêt», avait affirmé l’ANEF la saison dernière, qui fut exceptionnelle en termes de maîtrise des incendies. La baisse des dégâts s’expliquait aussi par une stratégie d’attaque précoce des feux, puisque la politique de prévention adoptée par les partenaires, incluant le ministère de l’Intérieur, l’ANEF, la Protection Civile, les Forces Armées Royales, et autres, a permis de maîtriser 80% des départs de feu avant qu’ils n’atteignent un hectare.
Dans ce contexte, la capacité d’anticiper les feux avant leur déclenchement devient un enjeu majeur. Pour Fouad Assali, chef du Centre national de gestion des risques climatiques forestiers, rattaché à l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, «avec l’impact du changement climatique, ressenti à l’échelle internationale, les prévisionnistes et spécialistes estiment que la pression des incendies de forêts augmentera de plus de 35% d’ici 2050. Il est donc impératif d’anticiper cette évolution par la mise en place de stratégies adaptées et par la mobilisation des ressources nécessaires, afin d’en limiter l’impact et les dégâts». L’expert précise que le Maroc fait d’ailleurs partie des pays qui sont dans cette dynamique et qui se dotent au fur et à mesure des moyens techniques et technologiques nécessaires.
Efficacité en action !
En effet, le plan d’action de l’ANEF, élaboré en collaboration avec la Direction Générale de la Météorologie, a permis de mobiliser des moyens d’alerte et d’intervention plus efficaces et plus performants, notamment par le pré-positionnement adéquat des moyens d’intervention terrestres et aériens, à proximité des lieux de départ possible d’incendies, ce qui se traduirait par la réduction des temps d’intervention et une plus grande efficacité des opérations.
Ce processus présente une carte quotidienne des scores de risques d’éclosion avec une résolution très fine, accompagné d’une analyse du risque, pour fournir de précieuses informations aux équipes prépositionnées sur le terrain, tout en prenant en considération des facteurs tels que l’évolution météo, des images satellites récentes, des informations socio-économiques, et sur la nature et l’état du couvert forestier.
Cela dit, l’ANEF appelle instamment les utilisateurs des espaces forestiers, tels que les campeurs, apiculteurs, éleveurs, à faire preuve de vigilance, rappelant qu’il est crucial de limiter l’utilisation du feu et de signaler immédiatement tout départ de feu ou comportement suspect aux autorités compétentes.
Le Maroc adapte-t-il sa stratégie face à l’intensification des risques liés au changement climatique, notamment en matière de moyens aériens ?
La concentration des feux de forêts que nous vivons est-elle inhabituelle ?
En réalité, non. Pour le Maroc, enregistrer huit incendies simultanés durant cette période n’est pas hors norme. Ce type de situation est gérable, mais il exige une vigilance permanente. D’autant que le dessèchement de la végétation est progressif et qu’il renforce mécaniquement les facteurs de risque. Nous observons également que certaines zones, notamment dans le Nord, ont connu un développement important de la biomasse végétale à la suite des pluies tardives, ce qui, une fois desséché, constitue un facteur aggravant. C’est pourquoi nos interventions intègrent aussi une approche préventive, avec des opérations de sylviculture et de gestion du combustible végétal.
Attirés par la présence de ces insectes, les oiseaux ne tardent pas à revenir vers ces zones qui sont pourtant encore loin d’avoir récupéré leur couvert végétal. Dans la majorité des cas, les mousses et petites plantes font leur apparition durant les 12 mois qui suivent l’incendie, surtout lorsque des conditions météorologiques et pluviométriques favorables sont au rendez-vous.
Grâce à leurs écorces, des espèces comme le pin ou le chêne-liège arrivent souvent à survivre au feu et entament doucement leur régénération naturelle durant les années qui suivent l’incendie. Dans le bassin méditerranéen, certaines espèces de faune réinvestissent les forêts régénérées après seulement une ou deux années de l’incendie.
En moyenne, il faut compter 3 à 5 ans afin de permettre aux herbes et aux arbustes de recouvrir les traces du feu. Ce n’est seulement que 20 à 30 ans après l’incendie que la forêt retrouvera son aspect initial. Contrairement à l’exemple des forêts méditerranéennes, certaines forêts tropicales, notamment en Amazonie, sont beaucoup moins résilientes aux incendies et nécessitent une à plusieurs centaines d’années avant de retrouver leurs caractéristiques et leur aspect original.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel