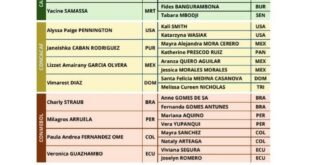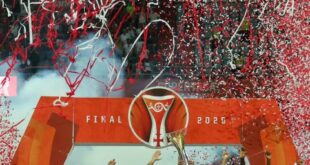Symbole fort d’une Afrique unie et tournée vers l’avenir, le gazoduc Afrique-Atlantique, ambitionne de relier l’Afrique et l’Europe. Ce projet stratégique s’inscrit dans la dynamique de l’Initiative Royale pour l’Atlantique, visant à faire de l’océan un vecteur d’intégration régionale, de souveraineté énergétique et de coopération Sud-Sud durable.
Le projet a été conçu comme une réponse aux multiples défis auxquels fait face l’Afrique de l’Ouest : un déficit énergétique chronique, une faible industrialisation, et une dépendance massive au bois de chauffe pour les usages domestiques. En connectant directement les gisements gaziers géants du Nigeria, pays qui détient les premières réserves prouvées du continent (5 900 milliards de m³), aux pays voisins et au Maroc, le gazoduc Afrique-Atlantique doit permettre de sécuriser l’accès à une énergie propre et relativement bon marché pour plus de 400 millions de personnes.
Concrètement, le tracé passe par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et enfin le Maroc. Il prévoit également des embranchements vers le Mali, le Burkina Faso et le Niger, permettant à ces pays enclavés de bénéficier indirectement du réseau. La capacité projetée est de 30 milliards de mètres cubes par an, soit trois fois celle du GME. Ce gazoduc est aussi conçu comme une infrastructure flexible, capable de transporter à l’avenir de l’hydrogène vert ou de l’ammoniac, en phase avec les ambitions climatiques de la région.
Depuis 2020, le projet a connu une forte accélération institutionnelle. L’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et la Nigerian National Petroleum Company (NNPC) ont lancé les premières études de faisabilité, suivies par les études d’ingénierie préliminaires. En 2022, une première série de mémorandums d’entente (MoU) a été signée avec les pays partenaires. Puis, en décembre 2024, la CEDEAO a validé officiellement le projet lors de son 66e sommet, en adoptant les premiers accords intergouvernementaux (IGA), préparant ainsi le terrain à une coordination régionale effective.
La gouvernance du projet repose sur une structure tripartite. Une société-holding regroupe trois Special Purpose Vehicles (SPV), chacune responsable d’un segment du gazoduc. Ce modèle garantit une répartition claire des responsabilités, facilite la levée de fonds et assure la coordination avec les différentes agences nationales de régulation. Le coût initialement estimé à 25 milliards de dollars a été revu à la baisse : selon Amina Benkhadra, directrice générale de l’ONHYM, le budget avoisinerait désormais 20 milliards de dollars, notamment grâce à la simplification du tracé côtier et à l’optimisation du phasage. La mise en œuvre du gazoduc se fera en trois phases. La première (2025–2029) concerne le tronçon nord, qui permettra une mise en service partielle et une connexion rapide au GME. La deuxième phase (2025–2030) portera sur le segment sud, depuis le Nigeria jusqu’à la Côte d’Ivoire. Enfin, la troisième phase (2035–2040) complétera le corridor sur toute sa longueur. L’objectif est de lancer les premiers flux de gaz entre 2029 et 2030, à condition que la décision finale d’investissement (FID) soit prise dès l’automne 2025, à la suite de la signature officielle des accords intergouvernementaux. En parallèle, plusieurs projets gaziers nationaux viennent renforcer la pertinence de ce corridor. En avril 2025, le champ o shore Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, a entamé sa première phase de production. Il en sera de même pour BirAllah (Mauritanie) et pour les projets nigérians comme Brass LNG. Le Maroc, de son côté, accélère le développement de ses infrastructures internes (gazoducs Nador–Kénitra–Mohammedia–Jorf Lasfar–Dakhla) ainsi que l’aménagement de terminaux GNL et de champs gaziers comme Tendrara et Anchois.
Le gazoduc Afrique-Atlantique ne se résume donc pas à une infrastructure de transport. Il représente une colonne vertébrale de l’intégration énergétique africaine, un levier de développement pour les économies ouest-africaines, et un outil diplomatique majeur pour renforcer la coopération euro-africaine dans un contexte de transition énergétique mondiale. Si les engagements sont tenus et les délais respectés, il pourrait redessiner, d’ici la fin de la décennie, la carte énergétique du continent.
Ce changement de main a permis de revoir les modalités contractuelles avec l’entreprise Italfluid, chargée de la conception et de la mise en œuvre de l’unité. Le contrat initial en mode leasing a été converti en contrat EPC (ingénierie, approvisionnement et construction) d’un montant total de 25 millions de dollars, dont 18 millions liés à l’avancement des travaux et 7 millions versés à leur achèvement.
L’unité de liquéfaction, qui traitera le gaz extrait des puits TE-10 et TE-5, jouera un rôle central dans la transformation du gaz en GNL (gaz naturel liquéfié), destiné à être stocké puis transporté par camion jusqu’aux clients finaux. Les opérations de raccordement des puits et d’installation du réseau de collecte sont, elles, programmées pour le troisième trimestre 2025.
Ce jalon est crucial pour assurer un démarrage rapide et e cace de la production. Grâce à cette nouvelle configuration, Mana Energy renforce son contrôle sur l’ensemble du processus industriel et améliore la rentabilité du projet. Le lancement de la production de GNL à Tendrara marquera une avancée stratégique pour la souveraineté énergétique du Maroc, en valorisant une ressource locale jusque-là sous-exploitée et en diversifiant les sources d’approvisionnement du marché intérieur.
À terme, le gazoduc permettra d’acheminer jusqu’à 30 milliards de pieds cubes de gaz par jour, aussi bien vers le marché marocain et ouest-africain que vers l’Europe, via le gazoduc Maghreb-Europe. La ministre de la Transition énergétique, Leïla Benali, a confirmé cette étape décisive, soulignant que des investisseurs privés et des fonds d’infrastructure ont manifesté leur intérêt, attirés par une rentabilité estimée entre 10 et 12 %.
Cette première phase intègrera également les réseaux gaziers de la Mauritanie et du Sénégal. Le projet s’inscrit dans la stratégie marocaine de diversification énergétique et de souveraineté, et illustre la volonté du Royaume de devenir un hub énergétique régional. Il constitue aussi une alternative géopolitique au projet concurrent de gazoduc transsaharien porté par l’Algérie.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel