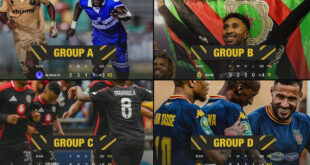Éclipsé depuis 12 ans, le réalisateur emblématique brésilien Walter Salles revient avec « Je suis toujours là ». Il y explore le cinéma comme reflet de la condition humaine, tout en abordant l’influence de la culture sur la narration, les subtilités de la direction d’acteurs et les défis de l’adaptation de récits. Interview.
Absolument, ce film est profondément ancré dans la jeunesse. C’est une célébration de la joie, de la vie, de la danse, du jeu et de la liberté. Ces expériences de ma jeunesse, vers 13 ou 14 ans, se sont révélées être des moments de découverte, mais aussi de confrontation avec une réalité sombre, celle d’un pays dépouillé d’un avenir possible. La musique, en particulier, jouait un rôle central à cette époque. Ce que vous écoutiez ou voyiez au cinéma définissait qui vous étiez.
En termes brésiliens, cette période coïncidait avec la naissance du mouvement Tropicalia, un mélange de nos racines afro-brésiliennes et des influences que des artistes comme Caetano Veloso et Gilberto Gil ont découvertes en exil en Angleterre, notamment avec l’introduction de la guitare électrique. Ce croisement culturel illustrait l’énergie et l’espoir d’un moment volé.
Vous avez décrit une atmosphère très particulière dans le film, notamment cette cohabitation entre l’oppression et la découverte infinie de l’adolescence. Quels souvenirs personnels vous ont inspiré cette dualité ?
Je me souviens d’une époque marquée par des contrastes saisissants. À cet âge, l’adolescence ouvre sur un monde infiniment plus vaste que ce que l’on imaginait, mais, en parallèle, un régime oppressif imposait des limites rigides. Cette coexistence de liberté et d’oppression a marqué ma jeunesse.
Une scène résume bien cette dualité : une femme nage dans l’océan, symbole de liberté, tandis qu’un hélicoptère vole trop bas, incarnant la surveillance militaire omniprésente. Ce paradoxe était omniprésent : la joie et la découverte étaient des formes de résistance face à l’oppression.
Votre dernier film semble explorer le contraste entre joie et oppression. Pourquoi était-il essentiel de montrer ces deux extrêmes ?
La première partie du film capture la joie et l’énergie d’une jeunesse insouciante, car, comme l’a dit une militante des Black Panthers dans un documentaire que j’ai vu récemment, ce n’est qu’en ayant vécu la joie qu’on peut comprendre l’ampleur d’une perte. Montrer cette lumière avant l’ombre était crucial pour comprendre la profondeur de l’impact des événements oppressifs qui suivent. Pour moi, vivre avec joie était une forme de résistance.
Vous avez évoqué l’importance de structurer le film en deux actes pour faire ressentir pleinement la joie, avant de basculer dans l’oppression. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette approche narrative ?
Il était crucial de permettre au spectateur de ressentir la joie dans toute son intensité avant de basculer dans l’oppression. Récemment, j’ai vu un documentaire intitulé « 32 Sounds », où une militante des Black Panthers expliquait que l’on ne peut comprendre l’ampleur d’une perte qu’après avoir pleinement vécu la joie. Bien que cette corrélation ne soit pas universelle, elle résonne profondément en moi.
Pour cette famille, vivre dans la joie était une forme de résistance. Lorsque cela leur a été arraché, la mère a dû incarner à la fois le rôle de mère et de père. Sa manière de retrouver sa force réside dans ce passé lumineux, un refus d’être vue comme une victime. Elle a transformé ce souvenir de bonheur en une nouvelle forme de résistance, entièrement la sienne.
Son intelligence émotionnelle extraordinaire. Elle possède cette capacité à comprendre qu’il est possible d’incarner une retenue tout en offrant de multiples couches de profondeur. C’est quelque chose de particulièrement difficile à réaliser.
Quand on travaille sur un registre d’expression minimaliste, où l’intensité apparente n’est pas énorme, il faut néanmoins parvenir à transmettre une richesse de nuances. Grâce à son talent et à son intelligence émotionnelle, elle a su faire cela brillamment. À un tel point que je la considère réellement comme une co-autrice du film.
Votre film mélange fiction et réalité, plongeant le spectateur dans une certaine incertitude sur ce qui est réel. Comment avez-vous pris la décision de construire ce film de cette manière ?
Cela concerne la « vivacité » du film. J’ai voulu créer une œuvre où ce que l’on perçoit devient presque tactile, une immersion totale dans l’instant. Cette approche découle en grande partie de mon expérience dans le documentaire, mais aussi de ce que j’ai appris auprès de cette famille, avec leur manière honnête et directe de voir et de vivre le monde.
Une autre manière de répondre à votre question est d’évoquer les archives présentes dans le film. Les images d’archives utilisées sont authentiques, elles représentent exactement ce que nous voyions à l’époque. Cette authenticité se reflète dans la façon dont elles s’entremêlent avec la fiction. En fait, la partie fictive du film a une esthétique qui la rapproche du documentaire, ce qui donne à l’ensemble une texture homogène.
Le style de ce film est audacieux. Par moments, il évoque le cinéma des années 1970. Comment avez-vous exploré ce style par rapport à vos œuvres précédentes, comme « Central do Brasil » ou « Carnets de voyage » ?
Ce film m’a permis d’aller plus loin dans l’exploration de ce que j’appelle la « vivacité » du cinéma. Même si « Carnets de voyage » avait un peu de cette essence, ici, j’ai cherché à capturer cette intensité tout au long du film. Cela n’a été possible que grâce à l’engagement des acteurs, comme Fernanda Torres, qui ont accepté de jouer sans donner l’impression de « jouer ».
J’ai toujours été fasciné par l’idée que le cinéma devient réellement intéressant lorsque, sur le plateau, on a l’impression que l’on ne tourne pas un film. Quand l’équipe disparaît presque et que la réalité émerge naturellement, cela donne une authenticité unique. Cela avait déjà fonctionné dans « Central do Brasil », où la perte de contrôle sur une procession religieuse a donné lieu à des scènes authentiques. Mais ici, il fallait maintenir cette alchimie tout au long du film, avec un casting large et une synergie totale entre les acteurs.
Oui, dès le départ, je voulais que le générique ait une qualité narrative ou sensorielle. Souvent, lorsque les crédits défilent simplement, cela brise brutalement l’expérience du spectateur. Ici, j’ai voulu prolonger l’émotion du film.
Les crédits durent 8 minutes, et ce choix est intentionnel. La maison, qui est un personnage à part entière dans le film, devient un vecteur de mémoire. Même si elle est abandonnée, elle continuera d’exister à travers le cinéma. Ces photographies, qui étaient le point de départ du projet, viennent compléter cette idée, en donnant une texture émotionnelle supplémentaire au film.
Vous avez mentionné que les changements politiques et culturels ont influencé certains de vos projets. Pouvez-vous expliquer cela ?
J’avais écrit deux scénarios originaux sur le Brésil, mais la réalité a évolué d’une manière qui a rendu ces projets obsolètes. Cela ne concerne pas seulement le Brésil : le zeitgeist a changé au cours de la dernière décennie. Contrairement à la musique, où l’on peut refléter immédiatement l’actualité, le cinéma exige une capacité d’anticipation pour rester en phase avec son temps. Malheureusement, ces deux scénarios manquaient de cette anticipation, et j’ai dû repenser mes projets.
Après avoir terminé un film de fiction, vous semblez souvent retourner à vos racines documentaires. Pourquoi cette alternance entre les deux genres ?
Chaque fois que je termine un film de fiction, je ressens le besoin de revenir aux documentaires, car ils représentent mes racines. Par exemple, j’ai réalisé une série documentaire sur Sócrates, un joueur de football brésilien qui a lancé un mouvement démocratique dans les années 1980. Ce projet s’inscrit dans une quête plus vaste de compréhension du retour à la démocratie au Brésil. Cette alternance m’aide à explorer des histoires qui mêlent intimement l’individuel et le collectif, un équilibre que je trouve fascinant.
Le film débute dans une ambiance sereine et insouciante, rapidement brisée par l’arrivée brutale de la dictature militaire. L’arrestation du père marque une rupture bouleversante, propulsant Eunice (Fernanda Torres, remarquable) dans un rôle de résistante déterminée à défier l’oppression pour sa famille.
La musique, omniprésente, devient une arme narrative puissante, sublimant chaque scène. Une séquence marquante juxtapose la violence d’arrestations militaires à une envolée mélodique, capturant l’angoisse et la résistance d’une génération.
L’utilisation de la caméra Super 8 ajoute une dimension visuelle unique, servant de lien entre les membres d’une famille séparée. Ces images personnelles apportent une respiration dans un récit oppressant tout en incarnant une modernité audacieuse.
Salles explore aussi la destruction de l’unité familiale, symbolisée par la maison abandonnée, et met en lumière les cicatrices toujours vives de l’Histoire brésilienne. Fernanda Torres livre une performance magistrale, mêlant force et fragilité, pour incarner la mémoire d’un peuple en lutte.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel