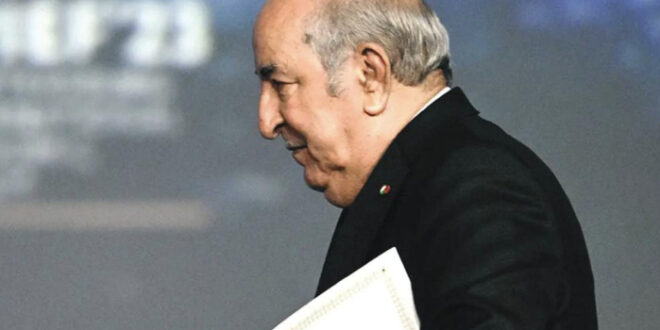Une volte-face embarrassante : La Banque Islamique de Développement (BID) a récemment annoncé un important programme de prêts en faveur de l’Algérie, d’un montant global de trois milliards de dollars sur trois ans.
Dans une déclaration accordée à la chaîne algérienne Al-Nahar, le président de la BID, Muhammad Sulaiman Al Jasser, a précisé que ce financement servirait à appuyer des projets de développement majeurs, en particulier dans le domaine ferroviaire, dans le cadre du plan présidentiel visant à connecter les zones économiques du pays.
Parmi ces projets figure notamment la ligne ferroviaire Alger–Tamanrasset, sur plus de 2.000 kilomètres, évoquée pour la première fois par Tebboune lui-même, de manière improvisée, lors d’un discours tenu à Tamanrasset en pleine campagne électorale, en décembre 2019. Une promesse à la tonalité électoraliste, qui n’a jamais été sérieusement étudiée sur le plan technico-économique.
Pris au mot et souvent interpellé sur cet engagement, le président tente depuis de justifier la faisabilité du projet, allant jusqu’à affirmer, à une époque, que le Qatar prendrait en charge sa réalisation. Le voilà aujourd’hui contraint de recourir à un prêt de la BID, reniant ainsi ses propres lignes rouges.
D’abord, aucune étude d’impact sérieuse ne semble avoir été menée pour définir la rentabilité, les délais ou les moyens techniques nécessaires à la réalisation de cette ligne ferroviaire – présentée comme un TGV, dans un pays qui peine déjà à entretenir ses voies existantes.
Ensuite, quel est l’intérêt stratégique ou économique de relier la capitale à une zone désertique à faible densité de population, à un coût faramineux ? Ce projet apparaît davantage comme une lubie électorale que comme une priorité de développement, dans un pays où les infrastructures de base manquent cruellement.
Ce discours, qui faisait de l’autonomie financière un symbole de puissance nationale, est aujourd’hui mis à mal par les faits. L’Algérie s’apprête bel et bien à s’endetter auprès d’une institution internationale, malgré des années de posture souverainiste.
D’après le Projet de Loi de Finances 2025, la dette intérieure atteignait 15.795,66 milliards de dinars au 30 juin 2024, soit 99,32% de la dette publique totale, fixée à 16.841,09 milliards DA. Cela représente 117,9 milliards de dollars au taux officiel (134 DA/USD), mais seulement 68,7 milliards USD au taux du marché parallèle (environ 230 DA/USD), plus proche de la réalité économique.
La structure de cette dette témoigne des dérèglements profonds de l’économie algérienne : 71,71% est constituée de dette d’assainissement, liée aux déficits des entreprises publiques, et 28,29% est de la dette courante, destinée au financement du budget de fonctionnement de l’État.
À fin 2024, cette dette équivalait à près de 50% du PIB, un niveau jugé encore soutenable, mais qui masque une dynamique préoccupante, d’autant plus que le pays ne dispose d’aucun mécanisme crédible de désendettement ou de relance productive.
En empruntant auprès de la BID, le pouvoir algérien invalide son narratif moralisateur à l’égard des pays africains dépendants des bailleurs internationaux. L’Algérie rejoint désormais ce club, sans en assumer pleinement le virage.
Dans une économie non diversifiée, dépendante à plus de 90% des hydrocarbures, les marges de manœuvre budgétaires s’amenuisent à grande vitesse. L’Algérie se retrouve prise à la gorge, contrainte de faire appel à des financements extérieurs qu’elle condamnait hier encore.
Une souveraineté minée par la dépendance énergétique La baisse des revenus pétroliers agit ici comme révélateur d’une vulnérabilité structurelle. Tous les plans de diversification économique annoncés depuis vingt ans ont échoué. L’Algérie reste incapable de produire de la valeur en dehors du pétrole et du gaz, ce qui la rend hautement sensible aux chocs exogènes.
Plutôt que d’anticiper ces risques, le pouvoir semble les découvrir avec retard, cédant à la panique budgétaire au lieu de mettre en œuvre des réformes de fond.
À court terme, cet emprunt pourrait permettre de financer certains projets d’infrastructure. Mais à moyen et long termes, il ouvre la voie à une dépendance croissante, en l’absence d’un véritable plan de redressement économique. Car la souveraineté ne se proclame pas dans les discours – elle se construit dans les faits.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel