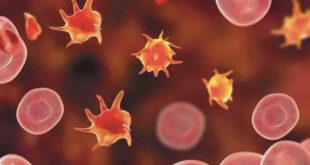La Chine a annoncé, le 12 juin, la suppression des droits de douane sur les produits en provenance de 53 pays africains, afin de leur faciliter l’accès à son gigantesque marché intérieur. Une initiative qui contraste avec la politique protectionniste de Trump, affectant durement certaines économies du continent. Mais derrière le discours politique, les obstacles structurels et les déséquilibres commerciaux demeurent.
Le gigantesque marché intérieur chinois, avec ses 1,4 milliard de consommateurs, s’ouvrira-t-il enfin aux exportateurs africains ? C’est la promesse de Pékin qui, le 12 juin, a annoncé la suppression des droits de douane pour les produits importés de 53 des 54 pays du continent africain. Cette déclaration a été faite à l’occasion de la rencontre commerciale Chine-Afrique à Changsha, dans la province du Hunan. Dans le contexte actuel, il est difficile de ne pas établir de parallèle entre cette initiative chinoise et la politique ultra-protectionniste de Trump, qui pénalise fortement certains pays africains. Souhaitant rééquilibrer la balance commerciale des États-Unis, le président américain a imposé des droits de douane à l’ensemble des économies étrangères, frappant certains pays plus durement que d’autres.
Message au Sud global
Si le Maroc s’en sort relativement bien, avec l’application du taux plancher de 10%, d’autres pays africains ont été moins chanceux, comme le Lesotho (50%), l’Afrique du Sud (30%), l’Algérie (30%) ou encore la Tunisie (25%). Tandis que les murs se dressent autour du marché américain, la Chine se positionne comme une alternative pour des économies africaines souvent fragiles et dépendantes des exportations de produits comme l’agroalimentaire ou le textile.
Sur le continent, l’Empire du Milieu est déjà en terrain conquis. Depuis 2008, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l’Afrique, surpassant ses concurrents occidentaux. Les échanges commerciaux bilatéraux ne cessent d’augmenter, passant de moins de 12 milliards de dollars en 2000 à 295,56 milliards en 2024.
Avec sa politique du “zéro tarif”, Pékin cherche à adresser un message clair aux pays africains et au Sud global : à la différence des puissances occidentales, la Chine respecte les règles du commerce international. En effet, le géant asiatique ne se présente pas en prédateur, mais en partenaire commercial fiable, engagé dans une relation gagnant-gagnant avec ses interlocuteurs africains.
Chantre du libre-échange
“Pour Pékin, il est important d’apparaître aux yeux de ces pays comme le chantre de l’ouverture économique et du libre-échange, prenant ainsi la place des États-Unis, qui l’ont été depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Balle a, en quelque sorte, changé de camp”, nous explique Xavier Aurégan, maître de conférences à l’Université catholique de Lille et auteur du livre “Chine, puissance africaine”. D’ailleurs, cette décision n’a rien de surprenant. Dès la deuxième édition du FOCAC (Forum triennal Chine-Afrique) en 2003, Pékin avait instauré un traitement tarifaire zéro pour une sélection de produits en provenance des pays africains les moins avancés. Ce dispositif a ensuite été élargi à 33 pays lors de l’édition de septembre 2024, avec l’ajout de 140 nouveaux produits, dont le riz, le blé, le sucre, le coton, l’huile de soja, les cigarettes, le bois, la laine ou encore le papier. Plus récemment, en juin, le mécanisme a été étendu aux restants des économies africaines à revenu intermédiaire, dont le Maroc, l’Afrique du Sud ou l’île Maurice. Au total, 53 des 54 pays du continent sont désormais concernés. Seul Eswatini en est exclu, en raison de ses relations diplomatiques avec Taïwan.
Marché impénétrable
Au-delà du message politique, cette exonération des droits de douane aura-t-elle un réel impact pour ces pays ? Rien n’est moins sûr. Tandis que les échanges commerciaux entre les deux partenaires sont en constante progression, atteignant 295,56 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 4,8% par rapport à 2023, le déficit commercial reste abyssal pour le continent : 61,93 milliards de dollars en 2024, contre 64 milliards l’année précédente. Les pays africains ne parviennent à exporter vers le géant asiatique, dans leur grande majorité, que des ressources naturelles ou des produits peu transformés, principalement du pétrole, du cuivre et d’autres minerais. Ces produits, indispensables à l’appareil industriel chinois, figurent parmi les principales raisons de l’intérêt que Pékin porte au continent. En revanche, les produits à plus forte valeur ajoutée peinent à pénétrer le marché chinois, tant la concurrence y est féroce.
Même pour un pays relativement industrialisé comme le Maroc, la majorité des exportations vers la Chine reste concentrée sur des produits primaires, tels que le phosphate et ses dérivés, les produits agricoles ou les fruits de mer. Les exportations marocaines à contenu technologique ou industriel peinent encore à s’y faire une place. “Sur le plan structurel, le continent africain, y compris ses économies les plus industrialisées, ne dispose pas des capacités nécessaires pour rivaliser avec la puissance de production chinoise, quel que soit le secteur”, résume Xavier Aurégan.
Besoin d’investissements
En attendant d’en savoir plus sur le dispositif chinois du “zéro tarif”, on peut s’attendre à ce que Pékin réclame une forme de réciprocité de la part des pays concernés, en ouvrant davantage leurs marchés aux produits chinois. “Il est possible que, sur les produits de moyenne à haute technologie, les acteurs économiques et politiques chinois attendent une contrepartie. Cela pourrait passer par une ouverture plus large des marchés africains, avec des droits de douane réduits. On pense notamment aux technologies vertes, comme les panneaux solaires”, estime notre spécialiste.
Ne représentant qu’à peine 3% des échanges mondiaux de biens et services, l’Afrique demeure en deçà de son potentiel, malgré l’abondance de ses ressources. Pour accélérer son développement, le continent a surtout besoin d’investissements industriels, bien plus que d’un simple accès à de nouveaux marchés.
Sur ce plan, la Chine reste encore en retrait par rapport aux pays européens et aux États-Unis en matière d’investissements directs étrangers (IDE). Pour 2024, les IDE chinois en Afrique sont estimés à 42 milliards de dollars, avec une diversification progressive vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, tels que la pharmacie ou la transformation agroalimentaire.Toutefois, ces investissements demeurent inégalement répartis à travers le continent. Des pays comme le Maroc et l’Égypte concentrent une large part de ces flux. Dans le Royaume, les IDE chinois sont passés de 56 millions de dollars en 2022 à 1,6 milliard de dollars en 2024, une dynamique appelée à s’accélérer dans les prochaines années, notamment dans l’écosystème des batteries électriques.
Soufiane CHAHID
3 questions à Xavier Aurégan : « La Chine n’a pas vocation à industrialiser l’Afrique »
La suppression des droits de douane par la Chine sur les importations africaines peut-elle réellement profiter aux économies du continent ?
La nature des exportations africaines vers la Chine montre qu’il s’agit essentiellement de produits bruts, non transformés ou très faiblement transformés. Aujourd’hui, la structure de ces échanges reste donc très basique : les exportations de produits manufacturés africains vers le marché chinois demeurent très limitées. À ce titre, on ne peut pas dire que, dans les faits, la Chine prend des risques en supprimant les droits de douane, puisque les exportations africaines restent faibles, et que les produits industriels africains ne sont en aucun cas en mesure de concurrencer ceux du marché intérieur chinois.
Donc, l’Afrique ne peut pas compter sur la Chine pour s’industrialiser ?
Il s’agit avant tout d’une mesure relevant de la rhétorique politique, dans un contexte de rivalité commerciale avec Washington. C’est un message adressé au Sud global pour affirmer que la Chine soutient les économies en développement. Mais dans les faits, cette initiative est loin de constituer un levier sérieux pour l’industrialisation du continent africain. D’ailleurs, la Chine n’a pas véritablement vocation à industrialiser l’Afrique. Lorsqu’on examine les montants des investissements directs chinois, pays par pays ou même à l’échelle continentale, ils restent bien trop faibles pour avoir un impact significatif sur le développement industriel du continent.
Les relations entre la Chine et l’Afrique se résument-elles à des échanges commerciaux, sans réelle volonté de contribuer au développement du continent ?
Non, il y a bien sûr un peu de tout. On trouve de l’aide au développement, ainsi qu’un certain niveau d’investissement. Il ne faut pas le nier. Mais fondamentalement, l’intérêt principal de la Chine réside dans les contrats, c’est-à-dire les prestations de services que les entreprises chinoises exportent à l’étranger, notamment en Afrique. Selon les années, entre un quart et un tiers des contrats remportés par la Chine dans le monde concernent le continent africain. À cela s’ajoutent les flux commerciaux, avec d’un côté les exportations chinoises vers l’Afrique, et de l’autre l’importation de matières premières africaines, qui sont ensuite transformées en produits finis en Chine. Quant aux investissements directs chinois et aux prêts, autrefois très présents sur le continent, ils sont aujourd’hui beaucoup plus encadrés. Pékin a mis en place des règles plus strictes, intégrant désormais une évaluation plus rigoureuse du risque, aussi bien pour les prêts de l’Exim Bank of China que pour ceux de la China Development Bank.
Recueillis par
Soufiane CHAHID
Nouvelles routes de la soie : La Chine accélère ses investissements
Les investissements de la Chine dans le cadre de l’Initiative “Nouvelles routes de la soie» ont atteint des niveaux record au premier semestre 2025, avec 176 contrats signés pour un montant total de 124 milliards de dollars, dépassant déjà les chiffres de 2024. Cette accélération reflète une volonté de Pékin de renforcer sa présence mondiale face au ralentissement économique intérieur et aux tensions avec les États-Unis. Les secteurs de l’énergie, des mines et de la technologie concentrent l’essentiel de ces flux. L’énergie, notamment le pétrole, le gaz et les renouvelables, représente 44 milliards de dollars, avec un projet phare de 20 milliards au Nigeria. Les investissements verts progressent également, atteignant 9,7 milliards pour 12 GW de capacités. Le secteur minier, tiré par les besoins en cuivre et aluminium, totalise 24,9 milliards, surtout en Asie centrale. Les industries de pointe (batteries, hydrogène vert, panneaux solaires) reçoivent 23,2 milliards. Pékin privilégie désormais les prises de participation directes plutôt que les prêts souverains, pour limiter le surendettement des partenaires.
Guerre commerciale : Accord avec la Chine, menaces sur l’UE
Le 27 juin, la Chine et les ÉtatsUnis ont signé un accord commercial visant à réduire considérablement les droits de douane imposés lors de leur guerre commerciale. Washington s’est engagé à abaisser ses surtaxes, qui pouvaient atteindre jusqu’à 145%, à un niveau de 30%, tandis que Pékin réduira les droits sur les produits américains à environ 10%. Cet apaisement entre les deux premières économies mondiales vise à relancer les échanges bilatéraux et calmer les tensions. Toutefois, Donald Trump maintient une position beaucoup plus dure vis-à-vis de l’Europe. Selon le Financial Times, il exige désormais un plancher de 15 à 20% de droits de douane sur les importations européennes, sous peine d’augmenter ces taxes à 30% dès le 1er août. Cette pression a fait chuter les marchés américains, avec un recul du Dow Jones et du S&P 500. L’UE, qui bénéficie actuellement d’un taux de 10%, a suspendu ses contre-mesures sur 21 milliards d’euros de produits américains, mais les grandes capitales européennes préparent une riposte. Emmanuel Macron appelle à une réponse unie et ferme, tandis que Bruxelles envisage des alliances avec le Canada ou le Japon. Des représailles ciblées pourraient viser les secteurs de la technologie, de l’agroalimentaire et de l’automobile. Le commissaire Maroš Šefčovič rappelle que tous les scénarios restent possibles. À l’approche de la date butoir du 1er août, le contraste est saisissant : désescalade avec Pékin, bras de fer avec l’Europe.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel