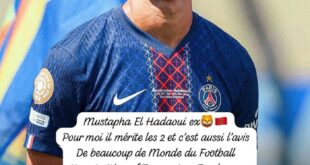Après tant de débats et de polémiques juridico-politiques, la réforme de la procédure pénale a achevé son parcours législatif. Un texte loin de faire l’unanimité. Détails.
Droit de la défense : Entre satisfaction et indignation !
Il s’agit, selon lui, “de s’assurer de la commission du crime et de poursuivre ses auteurs, et, d’autre part, la recherche de l’innocence, en garantissant les conditions d’un procès équitable”. D’où les nombreuses mesures prises pour renforcer le droit de la défense dont la mise en place de l’enregistrement audiovisuel pendant la garde à vue et la réduction des cas de recours à la détention préventive. Pourtant, les avocats n’en sont pas satisfaits. Ils jugent le texte peu avancé en ce qui concerne leurs prérogatives et reprochent au ministre de tutelle de n’être pas allé jusqu’au bout de ses promesses. L’Association des Barreaux du Maroc (ABAM) a critiqué “plusieurs reculs”, surtout quant à la présence des robes noires pendant les premières heures de la garde à vue et les interrogatoires de police. L’un des principaux reproches concerne la limitation de l’enregistrement audiovisuel à la lecture et la signature du procès-verbal. Bref, les avocats s’estiment marginalisés pendant l’enquête préliminaire et se voient affaiblis par rapport à l’accusation publique.
Les deux articles sulfureux !
Par ailleurs, c’est la question de l’accès des associations à la Justice dans les affaires de corruption qui a soulevé le plus de débats aussi bien au Parlement que sur la scène médiatique. La réforme a interdit aux associations et aux ONG anti-corruption de saisir la Justice et de déposer plainte dans les affaires liées aux deniers publics. L’article 3 consacre le monopole du plus haut sommet du ministère public. Seul le Procureur du Roi près la Cour de Cassation, en tant que président du parquet, peut lancer des poursuites et des actions judiciaires de son propre chef en cas de soupçon ou sur la base des rapports des hautes institutions de l’Etat comme la Cour des Comptes, l’Inspection des Finances ou les différents corps d’inspection des administrations publiques. Aussi, la capacité d’ester en justice est-elle plus restreinte qu’avant. L’article 7 exige aux associations d’obtenir une autorisation du ministère de tutelle pour pouvoir se déclarer partie civile, en plus d’une série d’autres conditions. Des obstacles critiqués à la fois par le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) et le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE). Pour le ministre de la Justice, il s’agit d’un gage de protection pour les élus contre les associations qui se servent de la lutte contre la corruption à des fins purement politiques. Il faut reconnaître à Abdellatif Ouahbi la cohérence de son discours, aussi controversée soit-il, puisqu’il l’a tenu depuis le début et l’a assumé politiquement.
En somme, le texte n’a pas subi beaucoup de changements dans la deuxième Chambre après avoir été considérablement amendé par les députés sans toucher les articles controversés. Près de 200 amendements ont été acceptés. S’il y a un objectif officiellement assumé, c’est la modération de la politique pénale de sorte à ce que la réforme est censée théoriquement limiter le recours à la détention pour soulager la pression sur les établissements pénitentiaires. Pour l’instant, les efforts de rationalisation de la détention commencent à donner leurs fruits. Selon les derniers chiffres du Ministère public, la part des détenus à titre préventif dans la population carcérale ne dépasse pas 30% à fin mai 2025 après avoir culminé à près de 45% durant les années précédentes.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel