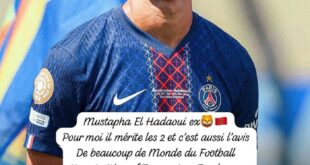Situé au carrefour de l’Europe et de l’Afrique subsaharienne, le Royaume mène depuis longtemps une lutte acharnée contre la propagation des drogues. Or, malgré les efforts déployés, un rapport de l’ONUDC souligne une hausse préoccupante de la consommation de certaines substances, notamment chez les jeunes.
Plus alarmante encore est la hausse de plus de 10% de la consommation non médicale de médicaments chez les moins de 18 ans. Le détournement de médicaments prescrits, souvent facilité par l’absence de contrôle parental ou de suivi médical, traduit une banalisation inquiétante de substances hautement addictives, apprend-on de même source. L’usage de l’héroïne reste marginal à l’échelle nationale, mais en hausse de 5 à 10% chez les mineurs, exposant cette population à un risque d’addiction rapide et sévère.
Les données de 2021 incluses dans le rapport montrent que près de 10% des patients marocains en traitement pour dépendance citaient le Tramadol comme substance principale. Ce chiffre place le Maroc parmi les pays les plus concernés d’Afrique du Nord par l’abus de cet antidouleur opioïde. La consommation féminine de Tramadol dépasse celle des hommes, selon la même source, avec 17% des femmes addictes traitées pour cette molécule, contre 9% des hommes. Cette inversion des tendances habituelles fait du Maroc l’un des rares pays du continent où l’addiction au Tramadol est plus féminine que masculine, un phénomène encore peu analysé, mais dont les implications sociales et sanitaires sont majeures. Selon un précédent brief du Conseil économique, social et environnemental (CESE), en termes d’addiction, les femmes sont en situation de triple vulnérabilité. Sur le plan social, elles sont exposées aux risques de subir des violences et des abus sexuels, surtout en cas de précarité économique et d’usage de drogues. Elles atteindraient aussi plus rapidement, d’après plusieurs recherches, le stade d’abus et de dépendance à la consommation de substances psychoactives (antidépresseurs, alcool, drogues). Il y a également la vulnérabilité dite «étiopathogénique», du fait de facteurs neurobiologiques et hormonaux, comorbidité avec des troubles mentaux (dépression, troubles anxieux, etc.).
Le Maroc est également exposé à la montée des drogues de synthèse, en particulier les opioïdes, mais aussi les nouvelles substances très puissantes, telles que les nitazènes, identifiées récemment en Afrique de l’Ouest dans des mélanges dangereux comme le «kush». Si le Maroc n’est pas encore fortement touché, sa proximité géographique avec des clusters comme la Sierra Leone ou le Sénégal appelle à la vigilance.
Par ailleurs, si le Royaume doit multiplier les boucliers anti-drogue, le rapport de l’ONUDC pointe le manque de dispositifs adaptés aux mineurs, l’insuffisance des structures de réduction des risques et d’accompagnement psychosocial, et la disparité d’accès au traitement entre hommes et femmes, particulièrement criante dans les zones rurales ou marginalisées (Voir recommandations).
– Il s’agit d’un constat positif et rassurant face à la montée des inquiétudes concernant l’avenir de la nouvelle génération. Cela est notamment lié à l’approche volontariste du Maroc en matière de développement industriel du cannabis, qui vise à faire de cette plante un levier de développement socio-économique, tout en luttant contre son exploitation licite à des fins illégales. Le Maroc promeut ainsi l’usage médical du cannabis, contribuant à corriger les perceptions erronées autour de cette plante miraculeuse sur le plan thérapeutique. Les campagnes de surveillance renforcées dans les espaces publics et les établissements scolaires, menées pour lutter contre la consommation de drogues chez les mineurs, ont permis une prise de conscience croissante chez les enfants et leurs familles quant aux dangers liés à ces substances. Cependant, cela ne signifie pas que le Maroc a pleinement réussi à protéger sa jeunesse. La consommation de cannabis reste relativement stable chez les jeunes, ce qui montre que la transition vers l’âge adulte demeure une période critique qui nécessite une action durable pour prévenir les risques d’addiction.
Par ailleurs, une hausse de 10 % de la consommation non médicale de produits pharmaceutiques chez les mineurs a été constatée par l’ONU. Comment peut-on y remédier ?
– L’utilisation de produits médicaux à des fins détournées n’est pas un phénomène nouveau. De nombreux patients s’autorisent l’achat de doses plus importantes que celles inscrites par le médecin de certains médicaments, ce qui favorise l’addiction à ces substances. Toutefois, ce phénomène devrait être atténué grâce à la transformation numérique du parcours de santé, notamment avec l’introduction de la feuille de soins électronique. Ce dispositif permettra aux médecins de mettre en ligne le dossier médical complet du patient, y compris l’ordonnance, qui pourra ensuite être consultée par le pharmacien sans intervention du patient. Cela contribuera à limiter l’acquisition répétée de toute molécule en dehors de son cadre de consommation légitime.
Le Maroc demeure l’un des rares pays du continent africain où la proportion de femmes concernées par l’addiction au Tramadol dépasse celle des hommes (17% contre 9%). Comment expliquer cette situation ?
– Si l’ONU s’est basée sur des études concrètes de terrain pour tirer cette conclusion, il s’agit d’un constat très inquiétant qui soulève de nombreux défis. De nombreuses femmes utilisent cette molécule pour soulager la douleur en agissant sur des cellules nerveuses particulières de la moelle épinière et du cerveau, mais elles finissent par tomber dans l’addiction à ce produit médical. Cette tendance ne se limite pas à cette molécule, mais englobe également d’autres substances qui, à force d’être consommées, entraînent une dépendance chez les femmes.
Le document appelle aussi à adapter la réponse pénale à la réalité du trafic, en mettant fin aux opérations policières indifférenciées, plaidant pour des réponses judiciaires ciblées, qui s’attaquent aux structures spécifiques des groupes criminels organisés, plutôt qu’à des consommateurs non violents.
Le rapport recommande par ailleurs d’inclure des considérations écologiques dans les politiques antidrogue, compte tenu des effets néfastes, tels que la déforestation, la pollution de l’eau et la contamination chimique. A cela s’ajoutent les interventions sociales intégrées pour prévenir et atténuer les dommages liés aux drogues dans les environnements les plus vulnérables.
Vient ensuite le renforcement de la coopération internationale afin d’anticiper les mutations rapides des marchés de la drogue, lesquelles ne cessent de se diversifier et de se régionaliser. L’ONUDC appelle les États membres à partager davantage d’informations et de stratégies pour mieux contenir les effets globaux du problème mondial de la drogue.
 Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel
Annonces Légales et Bulletin Officiel Journal d'annonces légales et publicateur au bulletin officiel